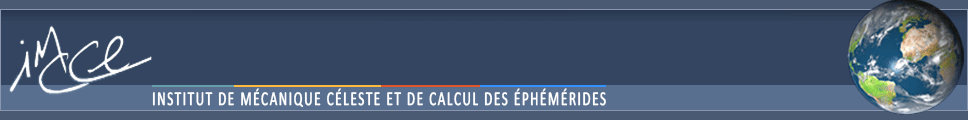
LA LETTRE D'INFORMATION DE L'IMCCE
N°118 : décembre 2015
|
Éphémérides du mois
de décembre 2015 (Repère géocentrique, les quadratures et les conjonctions sont en ascension droite) Les éphémérides sont données en temps légal français 3 décembre 4 décembre 5 décembre 6 décembre 7 décembre 10 décembre 11 décembre 12 décembre 14 décembre 18 décembre 21 décembre 22 décembre 25 décembre 29 décembre
Archives
Contacts
Directeur de publication
Comité de rédaction
Contributeurs
Conception
IMCCE - Observatoire de Paris |
|
ÉditorialNotre numéro de ce mois vient clôturer une année qui aura été riche en contenus relatés dans cette Lettre d'Information, l'un des contenus les plus riches depuis que cette LI existe. Cette année aura également été émaillée d'un certain nombre d'incidents informatiques que nous déplorons, et qui ont émoussé la réputation de régularité sans faille jusqu'alors dans l'envoi de cette LI. Encore en novembre, plusieurs images attachées au numéro de novembre n'avaient pas pu être correctement envoyées. Différentes évolutions sont prévues pour les mois à venir, en particulier une nouvelle interface de gestion des adresses des abonnés, modernisée, pour retrouver un niveau de fiabilité conforme à ce qu'il était dans le passé. En ces temps troublés, nous vous souhaitons une bonne fin d'année 2015, accompagnés des articles parfois étonnants que nous avons préparés. Le comité de rédaction Visibilité des planètes(Planètes visibles entre les latitudes 60° Nord et 60° Sud et les constellations les plus voisines) Mercure est visible le soir au crépuscule à partir du 19 décembre, date de sa première visibilité du soir à Paris. Elle se trouve dans la constellation d'Ophiuchus jusqu'au 7 décembre, date où elle entre dans la constellation du Sagittaire. Vénus est visible tout le mois en fin de nuit et à l'aube. Elle se trouve dans la constellation de la Vierge jusqu'au 11 décembre, date où elle entre dans la constellation de la Balance. Mars est visible tout le mois en fin de nuit et à l'aube. Elle se trouve tout le mois la constellation de la Vierge. Jupiter est visible tout le mois en fin de nuit et à l'aube, puis en seconde partie de nuit et à l'aube. Durant tout le mois, elle se lève de plus en plus tôt. Elle est tout le mois dans la constellation du Lion. Saturne est visible en fin de nuit et à l'aube à partir du 18 décembre, date de son lever héliaque du matin à Paris. Elle se trouve tout le mois dans la constellation d'Ophiuchus.
Ciel du moisCartes du ciel pour une observation vers le nord et vers le sud Ces cartes du ciel montrent les étoiles brillantes et les planètes visibles dans le ciel de l'hémisphère nord, vers l'horizon sud et vers l'horizon nord, pour le 15 décembre 2015 (23h). Le trait vertical correspond à la projection sur le ciel du méridien du lieu. L'arc de cercle rouge sur l'horizon sud représente l'écliptique (lieu de la trajectoire apparente du Soleil durant l'année). Les constellations visibles sur ces cartes sont, par ordre alphabétique des sigles : Andromède (And), le Verseau (Aqr), le Bélier (Ari), le Cocher (Aur), la Girafe (Cam), Cassiopée (Cas), Céphée (Cep), la Baleine (Cet), le Grand Chien (CMa), le Petit Chien (CMi), les Chiens de chasse (CVn), le Cygne (Cyg), le Dragon (Dra), Eridan (Eri), le Fourneau (For), les Gémeaux (Gem), le Lézard (Lac), le Lièvre (Lep), le Lion (Leo), le Petit Lion (LMi), le Lynx (Lyn), la Licorne (Mon), Orion (Ori), Pégase (Peg), Persée (Per), le Poisson (Psc), le Taureau (Tau), la Grande Ourse (UMa), la Petite Ourse (UMi),le Triangle (Tri). Le Soleil dans sa course apparente sur l'écliptique est accompagné de plusieurs planètes proches. Celles qui sont à l'est peuvent être observées au coucher du Soleil et au début de nuit selon leur élongation et leur magnitude, celles qui sont à l'ouest le seront en fin de nuit et au lever du Soleil sous les mêmes conditions. La figure suivante montre la configuration au 15 décembre 2015. Les cartes du ciel sont générées à l'aide du logiciel libre Stellarium. Phénomènes astronomiques
Cette année, le solstice d'hiver tombe le mardi 22 décembre à 4h 47m 57,86s UTC soit à 5h 47m 57,86s en heure légale française. Le terme solstice vient du latin solstitium (de sol « soleil » et sistere « s'arrêter, retenir ») car l'azimut du Soleil à son lever et à son coucher semble rester stationnaire pendant quelques jours à ces périodes de l'année, avant de se rapprocher à nouveau de l'est au lever et de l'ouest au coucher. À l'instant du solstice d'hiver, le Soleil entre dans le signe du Capricorne mais pas dans la constellation éponyme ; l'entrée dans le signe du Capricorne correspond à une longitude apparente du Soleil de 270° et à ce moment là, le Soleil est dans la constellation du Sagittaire. Ce jour là il passe au zénith pour un observateur de l'hémisphère sud situé sur le tropique; ce qui explique l'origine de son nom : le tropique du Capricorne. Notre calendrier, le calendrier grégorien, est un calendrier solaire. Il a pour but d'éviter la dérive des dates des saisons pr?sentes dans le calendrier julien. La durée des saisons variant sur de grandes périodes de temps, il est impossible de maintenir fixes les dates des saisons, tout au plus est-on capable d'éviter leurs dérives. Dans le calendrier grégorien et si l'on date le phénomène en temps universel, le solstice d'hiver peut tomber le 20, 21,22 ou 23 décembre. Il tombe en général le 21 ou le 22 décembre. Il est tombé un 23 décembre en 1903 et tombera de nouveau à cette date en 2303, 2307, 2311 et 2315. Il est tombé un 20 décembre en 1664, 1668, 1672, 1676, 1680, 1684, 1688, 1692, 1696 et 1697 et tombera de nouveau à cette date en 2080, 2084, 2088, 2092, 2096, 2488, 2492 et 2496.
Nouvelles astronomiquesLe 6 mai 2015, Pascal Richard, l'un de nos collaborateurs habituels au CNES pour les débris spatiaux, nous contacte pour nous parler d'une expérience intéressante : quelques jours plus tard, il va s'embarquer à bord du bateau Raphyo2 d'un autre de nos collègues au CNES, Richard Biancale, pour une traversée de l'Atlantique d'Ouest en Est. Germe alors l'idée d'une utilisation "à l'ancienne" des éphémérides de l'IMCCE, à partir de l'un des ouvrages que nous éditons régulièrement dans le cadre de notre mission de service public, pour faire le point en mer. L'histoire fait s'inverser les techniques, puisque dans le récit que nous vous invitons à télécharger, c'est la position par GPS qui sert de référence, et non plus l'inverse comme ça aurait pu être le cas il y a quelques années encore. Le traité de 1839 présente deux types de pilotage : le « cabotage » qui consiste à aller de cap en cap et la « navigation hauturière » ainsi nommée parce que l'on y fait usage de la hauteur des astres pour se guider. Le principe de base de la navigation hauturière est que la mesure de la hauteur d'un astre permet de calculer la distance de l'observateur au point de la sphère terrestre qui a cet astre à sa verticale ; ce point est nommé le pied de l'astre. Pour être utile, cette mesure doit être précise, car pour une minute d'angle d'erreur on fausse la distance d'un mille nautique (1852 mètres)......
PublicationsGrâce à cet agenda, chaque semaine de vos occupations terrestres sera mise en lueur par le quotidien céleste de la Lune, du Soleil et des planètes en présence dans le ciel. Il vous propulsera aussi toute l'année dans une dimension céleste grâce aux multiples découvertes que vous ferez à travers des sujets aussi variés que les différentes conceptions du monde de l'Antiquité grecque à nos jours, les personnages qui nous ont ouvert les yeux, les fondements de la relativité générale et ses applications aujourd'hui, les phénomènes de l'année à ne pas manquer… Ainsi, tout en plongeant dans l'histoire du temps, de l'espace et de leur relativité, cet agenda sera votre compagnon de route, celui du quotidien, et celui, entre terre et ciel, des chemins de la curiosité et de la connaissance. Le prix indiqué ne comprend pas les frais de port.
Les Lois de Képler dans tous leurs états
La trajectoire de STE-Quest sur deux jours : Kepler lui-même aurait-il pu imaginer qu'une telle orbite puisse suivre parfaitement ses fameuses lois ?? En guise de bouquet final de ce feuilleton 2015, nous présentons ce mois-ci des trajectoires aux formes très particulières, dont celles de la Station Spatiale Internationale, en orbite basse, et celle du projet STE-Quest, qui exploite une bonne partie des notions techniques présentées tout au long de l'année. On trouvera à nouveau dans les fiches à télécharger les notions d'inclinaison critique, de phasage, et de contraintes géographiques sur les régions de survol. La réalité du calcul opérationnel de trajectoires est bien plus complexe que les exemples, quelque peu académiques mais pour autant très réalistes, qui se sont accumulés au cours des épisodes du feuilleton. Les sources de perturbations, de nature gravitationnelle ou non gravitationnelle, sont légion : selon la sensibilité de la trajectoire, les propriétés peuvent être modifiées de manière significative en l'espace de quelques semaines ou années. Les préserver en permanence devient le domaine des opérateurs de satellites, pour le maintien à poste ou l'optimisation des dépenses d'énergie. Il resterait encore beaucoup à décrire, surtout si l'on prend conscience des codes de bonne conduite que doivent respecter désormais les opérateurs de satellites et agences spatiales de tous pays pour préserver l'accès à l'espace. Nul doute que Johannes Kepler n'avait pas imaginé de telles applications quand il exploitait de manière extrêmement minutieuse et astucieuse les observations de Tycho Brahé pour déduire le mouvement de Mars et des autres planètes. Aujourd'hui, ses lois sont toujours celles qui dominent l'ensemble des équations du mouvement des satellites artificiels, prenant en compte toutes les perturbations qui affectent le mouvement des satellites (dont l'amplitude n'excède pas un millième de l'attraction du corps central) ; elles sont associées à tout un ensemble de thématiques bien connues des ingénieurs qui opèrent les satellites (optimisation, correction de trajectoires dont maintien à poste, manoeuvres d'évitement), mais ce sont bien les lois de Kepler qui restent dans tous les cas prédominantes, et qui donnent l'ensemble des jolies trajectoires qui ont rythmé l'ensemble de cette année.

En direct du Laboratoire
Image de la rentrée de l'ATV-1 prise par Jérémie Vaubaillon en 2008 à bord d'un avion de la NASA. Financement ESA. Crédit : ESA, CalTech, IMCCE, OBSPM Un objet nommé WT1190F est rentré dans l'atmosphère terrestre au large des côtes du Sri Lanka le vendredi 13 novembre 2015 vers 06h17TU. Il s'agit apparemment d'un objet de quelques mètres carrés de surface et d'environ 2 tonnes. La courbe de rentrée est très particulière puisque le demi-grand axe est de plus de 300 000 kilomètres, et son excentricité presque égale à 1. L'évolution dynamique de sa trajectoire au cours des dernières années fait actuellement l'objet d'études, en collaboration entre l'IMCCE et le CNES, pour comprendre l'origine de la configuration qui le fait aujourd'hui rentrer sur Terre. La traversée de l'atmosphère s'est étalée entre les instants 2015-11-13T06:15:32 et 2015-11-13T06:20:07; ces cinq minutes ont cependant apparemment suffit pour que l'ensemble de la masse de l'objet se désintègre dans l'atmosphère, et aucun fragment n'est semble-t-il arrivé à la surface. Une campagne d'observation de la rentrée, financée par le projet FRIPON (IMCCE, MNHN, P11), a été organisée pour recueillir de précieuses informations sur la fragmentation de l'objet, mais les conditions météorologiques n'ont malheureusement pas rendu possible l'observation depuis le sol : il s'agissait de filmer puis de modéliser les phases de la destruction très rapide de l'objet, suite aux processus de chauffage engendrés par le freinage atmosphérique. L'organisation très rapide de cette campagne est cependant une bonne répétition pour d'autres événements similaires dans le futur, qui compte tenu de la répartition des débris spatiaux autour de la Terre, se reproduiront très certainement. Il s'agissait là très vraisemblablement d'un objet résiduel des missions Apollo à la fin des années 1960.
Séminaires
|
||||||||||||
| Haut de page | © IMCCE Tous droits réservés | http://www.imcce.fr |









-small.jpg)