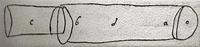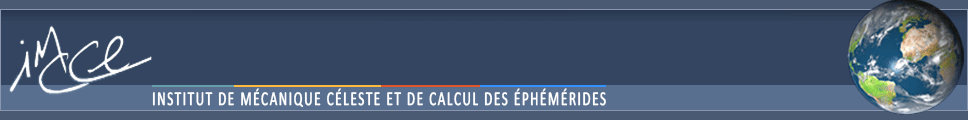
LA LETTRE D'INFORMATION DE L'IMCCE
N°45 : Avril 2009
|
éphémérides du mois
d'avril 2009 (Repère géocentrique, les quadratures et les conjonctions sont en ascension droite) Les éphémérides sont données en temps légal français 2 avril 7 avril 9 avril 11 avril 15 avril 16 avril 17 avril 18 avril 19 avril 21 avril 22 avril 25 avril 26 avril 28 avril
Archives
Contacts
Directeur de publication
Chef de rédaction
IMCCE - Observatoire de Paris |
|
Visibilité des planètes(Planètes visibles entre les latitudes 60° Nord et 60° Sud et les constellations les plus voisines)
Mercure entre dans la constellation du Bélier
Phénomènes astronomiquesAprès sa conjonction avec le Soleil le 24 janvier dernier, qui nous l'a caché pendant quelques mois, Jupiter est à nouveau observable le matin. L'opposition aura lieu le 14 août, ce qui va nous permettre de bien l'observer en 2009. En 2009, ce sera l'équinoxe sur Jupiter: le 22 juin, le Soleil se trouvera dans le plan équatorial de Jupiter. Cet événement, qui se produit tous les six ans (une demi-année jovienne), n'est pas sans intérêt pour nous les Terriens. En effet, l'équinoxe sur Jupiter va nous permettre d'observer, outre les éclipses des satellites dans l'ombre de la planète, des phénomènes uniques et spectaculaires, les éclipses et occultations mutuelles entre satellites. L'observation de ces phénomènes est une source précieuse d'information sur la nature et la structure des satellites. Elle permet une exploration du système de Jupiter depuis le sol terrestre à un coût bien moindre qu'une sonde spatiale. La brillance des satellites (magnitude 5: ils seraient visibles à l'oeil nu si Jupiter ne nous éblouissait pas) en permet l'observation par tout astronome amateur disposant d'un petit télescope et d'un matériel minimum. L'année mondiale de l'astronomie est l'occasion d'organiser un réseau international d'observation de ces phénomènes rassemblant amateurs et professionnels. Un "Special Project IYA09" a été lancé sur ce thème. Si vous voulez participer ou tout simplement observer ces phénomènes spectaculaires, rendez vous sur le site Internet de l'IMCCE à la rubrique Phénomènes mutuels 2009 où toutes les informations utiles sont données, en particulier la liste des phénomènes visibles depuis votre site d'observation. Nouvelles astronomiquesPrintemps 1609. La lunette astronomique fait son apparition à Paris. Elle n'a encore rien de l'instrument scientifique qu'elle deviendra par la suite. Sa fabrication est due au bricolage. Elle n'est nullement déduite d'une théorie optique. On l'appelle la lunette hollandaise car elle serait l'oeuvre de Zacharie Jansen ou de Hans Lippershey, tous deux natifs de Middelburg. Elle va se répandre en très peu de temps à travers l'Europe. On peut s'étonner de l'apparition si tardive de la lunette car dès la fin du XIIIème siècle les lentilles commençaient à être utilisées pour corriger les défauts de la vue. L'idée de combiner des lentilles pour allonger la portée de la vision humaine est apparue pour la première fois dans le Magia naturalis (la Magie naturelle) de Giambattista Della Porta (1589) qui n'était pas du tout un traité d'optique. Certains avaient déjà exprimé l'espoir de mieux percevoir les phénomènes du ciel grâce à des lentilles. Tels Roger Bacon en 1250, Léonard de Vinci en 1508. Fracastor, contemporain de Copernic, avait même pensé à utiliser deux lentilles superposées pour voir la Lune et les Etoiles de plus près. Cette lunette est faite de la combinaison d'une lentille convexe et d'une lentille concave. Les lentilles convexes donnent une image grossie et floue, les concaves une image diminuée et nette. Il faut donc associer les deux pour avoir une image grossie et nette. Ce n'est vraiment que vers 1600 que l'on pouvait trouver des verres de qualité suffisante et que les techniques de polissage s'étaient suffisamment développées pour fabriquer une lunette agrandissant à peu près deux fois. Cette lunette, personne n'en perçoit encore l'intérêt astronomique en ce mois d'avril 1609. Elle intéresse avant tout les états et les marchands. Mais bientôt Galilée en prendra connaissance. On lit parfois dans certaines revues que les axes du Grand Canal du château de Versailles sont orientés est-ouest et nord-sud. Certains en ont déduit, avec juste raison, que le Soleil devait se coucher dans l’axe du grand canal les jours des équinoxes. Or l’azimut de l’axe n’est pas parfaitement est-ouest, il s’en écarte d’environ 22° ce qui change considérablement les dates où ce phénomène est observable. L’altitude du sol devant la façade du château de Versailles tournée vers le Grand Canal est de 142 mètres, l’horizon dans la direction du Grand Canal est surélevé en raison d’une colline de 128 mètres d’altitude située à 10650 mètres. L’azimut de l’axe du Grand Canal est de 111°49'56", soit environ 111°50'. En tenant compte de la réfraction atmosphérique et de ces différents paramètres, nous avons calculé que le centre du Soleil se couche en 2009 dans l’axe du Grand Canal aux dates suivantes :
Attention : Si le Soleil à son coucher vous éblouit ne le regardez pas directement, c’est qu’il est encore trop haut sur l’horizon. Dans ce cas évitez de le photographier sans filtre, vous risquez d’endommager votre appareil photo et votre vue si vous utilisez un appareil à visée réflexe. L'astéroïde 2009 DD45 est un objet géocroiseur découvert le 27 février 2009, par Rob McNaught de l'Observatoire Siding Spring, en Australie. Le 2 mars 2009, à environ 15h - heure de Paris-, l'astéroïde est passé près de la Terre à une distance de 0,00048 UA (environ 64000 km). Pour un court intervalle de temps, d'environ deux heures, l'augmentation de la luminosité de l'astéroïde a permis aux astronomes de l'Observatoire de Paris d'effectuer des observations spectroscopiques de cet objet. Les données spectroscopiques en infra-rouge proche (0,8-2,5 microns) ont été obtenues en utilisant le télescope de 3 m de diamètre IRTF situé au Mauna Kea-Hawaii. Le télescope et le spectrographe SpeX ont été pilotés depuis le Centre d'Observation à Distance en Astronomie à Meudon (CODAM, hébergé à l'Observatoire de Paris). L'analyse préliminaire des données révèle deux bandes d'absorption, localisées à 1 et 2 microns respectivement, caractéristiques d'astéroïdes de type S (la surface riche en olivine et en pyroxène). En employant un albédo moyen de 0,36, caractéristique d'astéroïdes géocroiseurs de ce type (Delbo et al., 2003, Icarus 166, 116), et considérant une magnitude H=25,4, le diamètre moyen de l'objet a été estimé à une valeur de (19 +/ - 4) mètres. Le 6 octobre 2008 l'astéroïde 2008 TC3 était détecté 20 heures avant sa collision avec la Terre. Les programmes de surveillance du ciel opérés par les astronomes du monde entier ont permis de suivre l'objet et de prévoir avec précision l'instant et l'endroit de sa chute, située dans le désert de Nubie Soudan. Dans un article paru dans Nature (jeudi 26 mars 2006) une équipe internationale comprenant des astronomes de la NASA et de l'observatoire de Paris décrit la récupération de fragments de l'astéroïde et tente de faire le lien avec un corps parent plus massif. C'est la première fois qu'un tel événement a lieu. Il n'est pas rare qu'un petit astéroïde de ce type tombe sur la Terre, mais la plupart du temps l'évènement reste inaperçu. Grâce à des programmes d'observation des météores les scientifiques peuvent observer les dernières secondes de sa chute, lorsqu'il est déjà dans l'atmosphère et crée un flash très lumineux dans le ciel. La détermination de son origine est alors possible mais complexe. Le cas de 2008 TC3 est différent car il a été observé avant même sa chute. Dans le même ordre d'idée il est possible de déterminer l'origine astronomique des météorites trouvées sur Terre en examinant la façon dont ils réfléchissent la lumière et en les comparant aux astéroïdes observés dans nos télescopes. Le cas de 2008 TC3 est unique car les données minéralogiques et astronomiques sont disponibles en même temps pour la première fois. L'astéroïde en question faisait environ 4.1 m de diamètre, c'est-à-dire qu'il était suffisamment petit pour ne pas causer de dégât au sol. Il s'est désintégré haut dans l'atmosphère (37 km) trahissant sa nature fragile, ce qui laissait peu d'espoir de récupérer des fragments. Cependant Peter Jenniskens (SETI Institute, Californie) et Muawia Shaddad sont allés chasser les météorites dans le désert Soudanais avec une équipe d'enseignant-chercheurs et des étudiants de l'université de Khartoum. 47 météorites ont été trouvées, pour un poids total de 3.95 kg. L'analyse de la roche a montré qu'il s'agit d'une uréilite atypique, jusqu'ici jamais observée dans les collections de météorites, et associée à des astéroïdes de type S, alors que 2008 TC3 est de type F. Sa fragilité et sa porosité ont surpris tous les scientifiques. Les travaux de J. Vaubaillon de l'IMCCE (observatoire de Paris) basés sur l'évolution orbitale de 2008 TC3 ont montré que ce corps pourrait être lié à un autre astéroïde de type F beaucoup plus gros (1998 KU2, 2.6 km de diamètre). La détermination de la composition des roches extra-terrestres tombant sur Terre permet aux scientifiques de comprendre la formation du Système Solaire. De plus la surveillance du ciel permet de prévoir la chute d'astéroïdes géocroiseurs. Les petits objets comme 2008 TC3 (4.1 m, ~80 tonnes) ne font guère de dégâts au sol mais le risque de chute d'objet plus massif sur une zone habitée est pris au sérieux par les astronomes. Ce genre d'étude participe à un effort international dont l'Observatoire de Paris, à travers l'IMCCE, est déjà partie intégrante. Séminaires
|
| Haut de page | © IMCCE Tous droits réservés | http://www.imcce.fr |