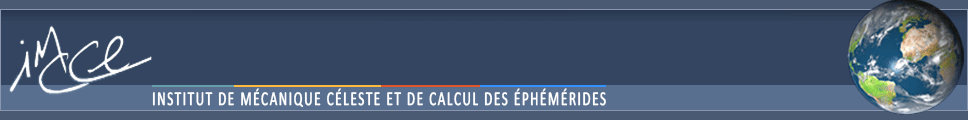
LA LETTRE D'INFORMATION DE L'IMCCE
N°46 : Mai 2009
|
éphémérides du mois
de mai 2009 (Repère géocentrique, les quadratures et les conjonctions sont en ascension droite) Les éphémérides sont données en temps légal français 1 mai 4 mai 7 mai 9 mai 14 mai 16 mai 17 mai 18 mai 19 mai 21 mai 24 mai 25 mai 26 mai 30 mai
Archives
Contacts
Directeur de publication
Chef de rédaction
IMCCE - Observatoire de Paris |
|
Visibilité des planètes(Planètes visibles entre les latitudes 60° Nord et 60° Sud et les constellations les plus voisines)
Mercure est stationnaire dans la constellation du Taureau
Phénomènes astronomiquesL'essaim des eta-Aquarides est célèbre car associé à la comète 1P/Halley : les poussières éjectées de ce corps entrent en collision avec la Terre chaque année en mai (eta-Aquarides) à une vitesse de 66 km/s. L'activité des eta-Aquarides commence dès la fin avril, et culmine en 2009 le 6 mai. Le niveau de la pluie devrait atteindre un taux horaire zénithal (ZHR) de l'ordre de 60 météores. Un autre essaim issu de la même comète croise l'orbite de la Terre en octobre et porte le nom d'Orionides. Nouvelles astronomiquesSelon les propres dires de Galilée, il entend pour la première fois parler de la lunette à Venise en mai 1609. Un étranger passant par Venise avait proposé un modèle au Sénat. Paolo Sarpi, ami de Galilée, lui demanda d'examiner cet instrument mais l'étranger était déjà parti pour Padoue. Galilée se renseigna sur l'instrument et put reconstruire la lunette. Galilée, dans son Messager des étoiles, a affirmé connaître les principes qui président au principe de la lunette. Il cherche à se faire passer pour le véritable inventeur de la lunette qui serait selon lui déduite de la théorie de la réfraction. Il le redira en 1623 dans l'Essayeur. Galilée s'oppose aux artisans. Il veut substituer des « raisons » aux « recettes » dans la lignée des grands ingénieurs-artistes de la Renaissance. Mai il n'en n'est rien. Par contre, dès 1604, Kepler dans son Optique, bien que n'abordant pas la question des combinaisons de lentilles, consacrait un long chapitre à la mesure des réfractions et à la recherche d'une loi dont il s'approchait autant que possible. Il rendait compte pour la première fois de la formation de l'image rétinienne. Il résolvait le problème du trajet des rayons à travers une sphère cristalline. Dès l'annonce des découvertes de Galilée, Kepler rédigea en août et septembre 1610 sa Dioptrique, publiée en 1611. Les principes optiques de la lunette y étaient clairement exposés. Kepler entendait justifier le Message en rapportant les découvertes de Galilée à leurs causes. Galilée ne se préoccupa des travaux de Kepler en optique qu'en octobre 1610, juste assez pour s'en former une opinion négative. Le télescope ne fut en définitive pas le produit de la théorie optique mais seulement son enfant adoptif. Il ne fut pas suscité par les besoins de l'astronomie mais l'on découvrit à postériori qu'il pouvait y répondre. Depuis la construction de la Grande Arche à La Défense, l’horizon n’est plus dégagé lorsque l’on regarde dans l’axe de l’Arc de Triomphe depuis les Champs Élysées. Une barre horizontale correspondant au sommet de la Grande Arche est visible sous l’arche de l’Arc de Triomphe, cette barre horizontale masque également une partie du Soleil couchant. Plus on s'approche de l'Arc, plus sommet de la Grande Arche est bas sur l'horizon, mais plus le diamètre apparent de l'arche augmente alors que le diamètre apparent du Soleil reste constant. Depuis la place de la Concorde, le diamètre de l’arche est vu sous un angle apparent de 23,6', le diamètre solaire est donc toujours plus important que cette valeur ; le Soleil ne sera donc jamais en entier sous l’arche. Ces calculs sont des prévisions tenant compte de la réfraction atmosphérique et du dénivellement entre un observateur situé place de la Concorde (au pied de l’obélisque) dans l’axe de l’Arc de Triomphe. Une variation même minime avec cet axe peut induire des différences notables dans l’azimut du Soleil (un mètre à droite ou à gauche change l’azimut d’environ 1,63') et des différences de temps de quelques dizaines de secondes sur les prévisions. Si vous vous déplacez vers la gauche de l’axe, le décalage de temps est négatif et si vous vous déplacez vers la droite de l’axe le décalage de temps se fait positivement. Le tableau suivant donne les jours et les heures de visibilité du phénomène (en heure légale française) :
Depuis le rondpoint Champs Élysée Clemenceau, le diamètre de l’arche est vu sous un angle apparent de 33,6', le diamètre solaire est donc quasi identique à cette valeur. C’est donc la position idéale pour photographier le Soleil sous l’arche. Ces calculs sont des prévisions tenant compte de la réfraction atmosphérique et du dénivellement entre un observateur situé au rondpoint Champs Élysées Clemenceau (au centre de l’avenue) dans l’axe de l’Arc de Triomphe. Une variation même minime avec cet axe peut induire des différences notables dans l’azimut du Soleil (un mètre à droite ou à gauche change l’azimut d’environ 2,32') et des différences de temps de quelques dizaines de secondes sur les prévisions. De nouveau, si vous vous déplacez vers la gauche de l’axe, le décalage de temps est négatif et si vous vous déplacez vers la droite de l’axe le décalage de temps se fait positivement. Le tableau suivant donne les jours et les heures de visibilité du phénomène (en heure légale française) :
Attention : Si le Soleil à son coucher vous éblouit ne le regardez pas directement, c’est qu’il est encore trop haut sur l’horizon.
Dans ce cas évitez de le photographier sans filtre, vous risquez d’endommager votre appareil photo et votre vue si vous utilisez un appareil à visée réflexe.
Séminaires
|
| Haut de page | © IMCCE Tous droits réservés | http://www.imcce.fr |








