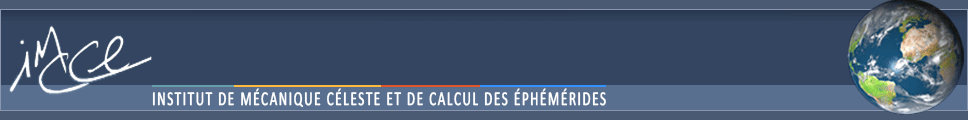
LA LETTRE D'INFORMATION DE L'IMCCE
N°94 : octobre 2013
|
Éphémérides du mois
d'octobre 2013 (Repère géocentrique, les quadratures et les conjonctions sont en ascension droite) Les éphémérides sont données en temps légal français 1 octobre 3 octobre 5 octobre 7 octobre 8 octobre 9 octobre 10 octobre 11 octobre 12 octobre 19 octobre 21 octobre 25 octobre 26 octobre 27 octobre 28 octobre 30 octobre 31 octobre
Archives
Contacts
Directeur de publication
Chef de rédaction
Rédacteurs
Conception et réalisation
IMCCE - Observatoire de Paris |
|
Visibilité des planètes(Planètes visibles entre les latitudes 60° Nord et 60° Sud et les constellations les plus voisines) Mercure est invisible durant le mois d'octobre bien qu'elle atteigne sa plus grande élongation le 9 octobre (25° 20'). Elle sera trop proche de l'horizon au coucher du Soleil pour être visible sous nos latitudes. Vénus est visible tout le mois, le soir au crépuscule et en début de nuit. Elle sera dans la constellation de la Balance jusqu'au 7 octobre, date où elle entrera dans la constellation du Scorpion qu'elle quittera le 15 pour faire un très court passage dans Ophiuchus jusqu'au 16 octobre, de nouveau dans la constellation du Scorpion jusqu'au 21 octobre date où elle retournera dans Ophiuchus. Mars est visible en fin de nuit et à l'aube. Elle sera tout le mois dans la constellation du Lion. Au cours du mois, elle se lèvera sensiblement toujours à la même heure. Jupiter est visible une grande partie de la nuit et à l'aube dans la constellation des Gémeaux. Saturne est visible dans la constellation de la Balance au crépuscule et en tout début de nuit jusqu'au 13 octobre, date de son coucher héliaque du soir à Paris. Uranus est visible toute la nuit dans la constellation des Poissons. Elle passera à l'opposition le 3 octobre avec une magnitude de 5.7. Comète ISON est visible en seconde partie de la nuit et à l'aube durant tout le mois d'octobre dans la constellation du Lion. Elle aura un passage proche de la planète Mars (10,843 millions de km) le 1er octobre à 17h 24m UTC.
Ciel du moisCartes du ciel pour une observation vers le nord et vers le sud Ces cartes du ciel montrent les étoiles brillantes et les planètes visibles dans le ciel de l'hémisphère nord, vers l'horizon sud et vers l'horizon nord, pour le 15 octobre 2013 (23h). Le trait vertical correspond à la projection sur le ciel du méridien du lieu. L'arc de cercle rouge sur l'horizon sud représente l'écliptique (lieu de la trajectoire apparente du Soleil durant l'année). Les constellations visibles sur ces cartes sont, par ordre alphabétique des sigles : Andromède (And), l'Aigle (Aql), le Bélier (Ari), le Cocher (Aur), le Bouvier (Boo), la Girafe (Cam), le Capricorne (Cap), Cassiopée (Cas), Céphée (Cep), la Baleine (Cet), la Couronne Boréale (CrB), les Chiens de Chasse (CVn), le Cygne (Cyg), le Dauphin (Del), le Dragon (Dra), le Petit Cheval (Equ), Eridan (Eri), les Gémeaux (Gem), Hercule (Her), le Lézard (Lac), le Lynx (Lyn), la Lyre (Lyr), le Serpentaire (Oph), Pégase (Peg), Persée (Per), le Poisson Austral (PsA), le Poisson (Psc), la Grande Ourse (UMa), la Petite Ourse (UMi), le Sculpteur (Scl), l'Ecu de Sobieski (Sct), le Serpent (Ser), la Flèche (Sge), le Sagittaire (Sgr), le Triangle (Tri), le Petit Renard (Vul). Le Soleil dans sa course apparente sur l'écliptique est accompagné de plusieurs planètes proches. Celles qui sont à l'est peuvent être observées au coucher du Soleil et au début de nuit selon leur élongation et leur magnitude, celles qui sont à l'ouest le seront en fin de nuit et au lever du Soleil sous les mêmes conditions. La figure suivante montre la configuration au 15 octobre 2013. Les cartes du ciel sont générées à l'aide du logiciel libre Stellarium. Phénomènes astronomiquesLa comète ISON (C/2012 S1) a été découverte le 21 septembre 2012 par V. Nevski et A. Novichonok à l'aide d'un télescope de 40 cm de l'International Scientific Optical Network (ISON) près de Kislovodsk en Russie. Son passage au périhélie aura lieu le 28 novembre 2013 à 18h 26,4m UTC. Elle sera alors à 1,17 million de kilomètres de la surface solaire, ce qui la classe comme comète Sungrazing. Son passage proche du Soleil sera observé par les sondes STEREO (http://stereo-ssc.nascom.nasa.gov/comet_ison/). Si elle ne se consume pas complètement lors de son passage au périhélie (la température sera alors de l'ordre de 2700°) et si elle ne se brise pas (elle se trouvera proche de la limite de Roche), elle deviendra une comète très spectaculaire que l'on pourra observer le soir après le coucher du Soleil en début du mois de décembre 2013, puis toute la nuit par la suite, car elle deviendra circumpolaire dans l'hémisphère nord. Une importante campagne d'observation est prévue. La comète a déjà été observée par le satellite Swift en janvier 2013 et par le télescope Hubble le 10 avril 2013 lorsqu'elle se trouvait à 630 millions de kilomètres de la Terre. Sa chevelure mesurait alors environ 5000 km, son noyau était estimé à environ 5 km et sa queue de poussière avait 92 000 km de long. En juin, la comète a été observée par le télescope spatial Spitzer, elle dégazait alors du dioxyde de carbone (CO2) avec un débit de mille tonnes par jour et un nuage de poussière avec un débit de 54 000 tonnes par jours. L'analyse des images a réduit l'estimation de la taille du noyau à moins de 200 m. Paul Wiegert de l'Université de Western Ontario a calculé qu'une pluie de fines particules (quelques microns de large) issues de la queue de la comète rencontrera la Terre vers le 12 janvier 2014 à la vitesse de 56km/s et qu'elle sera la source au niveau des pôles et à très hautes altitudes (dans la mésosphère ~80 km) de nuages noctulescents.
Nouvelles astronomiquesObserver les astres depuis l'espace a été l'un des premiers buts de l'ère spatiale. Si les satellites artificiels permettaient des observations nouvelles de la Terre, ils permettaient aussi une autre vision du ciel, étant affranchis de l'atmosphère terrestre qui trouble les images. En ce qui concerne l'astrométrie, s'affranchir de l'atmosphère terrestre signifiait éviter la turbulence qui déplace les images et donc diminue la précision en position. C'est ainsi que naquit le projet « Hipparcos » du nom d'Hipparque, le premier astronome astrométriste. Rappelons l'intérêt d'une observation encore plus précise : avec plus de précision de mesure, des objets fixes deviennent des objets mobiles et les objets mobiles ont une trajectoire mieux déterminée.
Conformément à l'arrêté du 3 avril 2001 du Ministère de l'économie, des Finances et de l'Industrie, relatif à l'heure légale française, la période d'heure d'été pour l'année 2013 se termine le dernier dimanche d'octobre à 3 heures du matin. Donc, la nuit du 26 au 27 octobre 2013, à 3 heures du matin il faut régler les horloges sur 2 heures. L'horloge parlante, située à l'Observatoire de Paris, diffuse l'heure légale française construite par le Laboratoire National de Métrologie LNE-SYRTE. Elle répond au numéro de téléphone : 36 99. Le début du quatrième top est exact au vingtième de seconde sur tout le territoire métropolitain. Le choix du méridien de Greenwich comme méridien origine et le découpage de la surface terrestre en 24 fuseaux horaires de 15° datent de la conférence internationale de Washington de 1884. Le temps moyen du méridien origine, le Greenwich Mean Time (GMT) sera remplacé en 1976 par une nouvelle dénomination le Temps universel UT, suivi de différentes variantes, actuellement on utilise le Temps universel coordonné (UTC) lié au Temps atomique international (TAI). L'usage de fuseaux horaires a permis de définir des zones horaires dans lesquelles le décalage horaire avec le Temps universel coordonné est constant. L'Europe est couverte par trois zones horaires définies par un décalage constant avec UTC.
Chaque pays européen a choisi, en fonction de sa longitude, une zone horaire. Chaque pays utilise en plus une heure d'été, cela se traduit, en période d'été, par un décalage horaire d'une heure supplémentaire par rapport à la zone horaire choisie. Afin de faciliter les relations entre pays, les pays de l'Union européenne effectuent leurs passages aux heures d'été et d'hiver, le même jour et au même instant. Un grand nombre des pays européens, non membre de l'Union européenne, font de même, seuls l'Islande, la Biélorussie, la Norvège pour les régions dénommées Svalbard & Jan Mayen ne suivent pas cette règle. En période d'été, les acronymes des noms civils deviennent respectivement WEST, CEST et EEST, la lettre S étant l'initial de « Summer ».

Le patrimoine sort de sa réserve
La lettre de l'IMCCE accueille désormais une nouvelle rubrique intitulée
"le patrimoine sort de sa réserve". Constitué de collections sur tous
supports (livres, photographies, archives, instruments, peintures,
sculptures...), le patrimoine de l'Observatoire de Paris est unique au
monde. Bien connu des historiens des sciences et de l'astronomie, il est
montré au public dans le cadre d'expositions temporaires in situ, et
également présent sur le web grâce à Alidade (une plateforme
d'inventaires en ligne), à des expositions virtuelles, des dossiers
thématiques (cf. http://www.obspm.fr/-patrimoine-.html).
C'est pour renforcer cette ouverture à tous les publics que nous avons
choisi de présenter dans cette nouvelle rubrique un objet patrimonial,
choisi de préférence en liaison avec l'actualité des collections :
expositions, restaurations, nouvelles acquisitions, découverte dans les
collections (oui cela arrive parfois !). -small.jpg)
Principe général de l'utilisation du sextant à deux lunettes perpendiculaires. Grâce à ce dispositif, il peut faire toute mesure de l'horizon au zénith à la façon d'un quart-de-cercle classique de 90° de secteur angulaire. Sur la figure sont représentés les angles de hauteur (h) et de distance zénithale (z). Le sextant visible dans la grande galerie de l'Observatoire de Paris est le seul des trois instruments mobiles de Nicolas Louis de Lacaille (1713-1762) qui nous soit parvenu. Il en fit l'acquisition auprès de Claude Langlois, quelque temps avant son départ pour le Cap de Bonne-Espérance le 20 novembre 1750 où il séjourna jusqu'en 1753. L'une des ambitions de Lacaille est de poursuivre et compléter à l'aide du sextant son relevé des hauteurs méridiennes des étoiles brillantes jusqu'à la magnitude 3 (pratiquement toutes les étoiles que l'on peut voir actuellement dans un ciel aussi lumineux que celui de Paris) qu'il avait commencé en 1749 dans son observatoire personnel du collège Mazarin à Paris. Le sextant est un instrument dédié à la mesure de l'angle de hauteur des astres au-dessus de l'horizon - ou de leur distance angulaire au zénith (La mesure de la hauteur méridienne d'un astre permet d'accéder à sa déclinaison - l'une des deux coordonnées angulaires nécessaires à la constitution d'un catalogue de positions d'étoiles - à partir de la connaissance de la latitude du lieu où est effectuée l'observation). Cette mesure se fait à l'aide d'une portion d'arc de cercle ; l'amplitude de cet arc donne son nom à l'instrument : quart-de-cercle pour des arcs de 90° ou secteur zénithal pour des arcs très réduits ne servant qu'à l'observation d'astres très proches du zénith (verticale du lieu). Cet arc de cercle, gradué généralement de dix en dix minutes d'angle, est appelé limbe. Le sextant de Lacaille a quant à lui une amplitude de 64° (d'où son nom de sextant). Son rayon est de 6 pieds (un peu moins de 2 m). La carcasse est en fer tandis que le limbe est en cuivre assujetti à un arc en fer. Un fil à plomb pendant jusqu'au limbe et protégé de toute agitation par un garde-filet est accroché au centre du sextant ; il sert à indiquer la verticale et donc la direction du zénith. La visée d'un astre s'effectue à partir de l'une des deux lunettes fixées sur le bâti en fer, perpendiculaires entre-elles et alignées sur les graduations 0 et 60°. Chacune est équipée d'un micromètre à curseur permettant la lecture - en théorie - de la seconde de degré. Le micromètre est disposé au foyer commun de l'objectif et de l'oculaire dont le champ sur le ciel est proche du degré. Il se constitue principalement d'un fil horizontal fixe et d'un fil mobile qui lui est parallèle. La mesure se fait en amenant l'astre visé à peu près sous le fil fixe, le limbe est ensuite déplacé à l'aide de la verge de rappel jusqu'à ce que le fil à plomb tombe sur le point de division le plus voisin lu avec un microscope; il suffit ensuite de tourner la vis du micromètre pour amener le fil mobile sur l'astre. La distance en minutes et secondes de degré du fil mobile au fil fixe - calculée à partir du cadran du micromètre divisé en cent parties - est précisément ce qu'il faut ajouter ou retrancher à la hauteur marquée par le fil à plomb. L'apposition de deux lunettes permet de transformer le sextant en un pseudo quart-de-cercle: l'une des lunettes - dite lunette horizontale - permet la mesure directe sur le limbe des hauteurs depuis l'horizon jusqu'à 64° de hauteur ; l'autre lunette - dite verticale - permet la mesure directe sur le limbe de la distance au zénith depuis la verticale jusqu'à une valeur de 64° (ce qui correspond à 26° de hauteur). Les deux lunettes disposent donc d'une zone commune de visée large de 38°, de part et d'autre de la hauteur 45°. Ce dispositif à deux lunettes perpendiculaires a été utilisé par Lacaille pour calculer sa table des réfractions atmosphériques. En tirant profit de l'observation d'une même étoile depuis deux lieux très éloignés en latitude - Paris et la ville du Cap présentent une différence de latitude de 82° environ -, il lui est alors possible d'inférer l'effet de la réfraction atmosphérique. La table des réfractions qu'il a ainsi établie, après son retour en France en 1754 - par d'autres observations menées au sextant jusqu'en 1756 - lui a permis de réduire l'ensemble de ses observations de distances zénithales effectuées depuis 1749 à Paris et au Cap par élimination de cet effet. Il peut alors publier en 1757 son premier catalogue de 397 étoiles brillantes - la totalité des étoiles du ciel visibles jusqu'à la magnitude 3 - sous le titre d'Astronomiae fundamenta. Quant à sa table des réfractions, elle sera introduite dans la Connaissance des Temps pour l'année 1760 aux côtés de celles de Cassini I établies en 1662 et ce pendant sept années consécutives. PublicationsÀ l'occasion du tricentenaire de la naissance de Nicolas Louis de Lacaille (1713-1762), l'Observatoire de Paris organise une exposition du 14 septembre 2013 au 28 mars 2014 consacrée à sa vie et son œuvre. l'IMCCE et l'Observatoire de Paris publient une brochure sur cet astronome méconnu mais dont les multiples contributions à l'astronomie ont permis des avancées majeures au XVIIIe siècle. Cette brochure contient aussi le carnet de l'exposition sur Nicolas Louis de Lacaille. Sommaire :
56 pages couleur illustrées En vente par correspondance ou sur site lors des visites. Contact : Sandra Drané , sandra.drane@obspm.fr
Accueil des groupes et individuels sur réservation visite.paris@obspm.fr Cet agenda est une invitation au voyage vers de nouveaux horizons jusqu'alors demeurés mystérieux, un appel à l'évasion inspiré par la splendeur luxuriante de ces espaces lointains et par la richesse infinie de ces mondes indéfinis que l'astronomie nous dévoile peu à peu. Levez l'ancre à destination de ces terres inexplorées de la connaissance. Plongez dans l'histoire de ces hommes et femmes passionnés dont les découvertes ont bouleversé la science. Émerveillez-vous face au sublime des phénomènes célestes. Et déjouez enfin les rouages obscurs créant ordre et beauté dans la mécanique des cieux. Cet agenda sera votre compagnon de route, le journal de bord marquant le rythme incessant de vos occupations terrestres, tout en laissant vagabonder votre esprit à la dérive dans l'immensité calme et voluptueuse du ciel insondé, comme l'écrit Baudelaire de sa plume lascive, "par-delà les confins des sphères étoilées "... Pour 2014, le thème développé au fil de l'année concerne la mission Rosetta et les comètes, dont la fameuse comète ISON. Le prix indiqué ne comprend pas les frais de port En vente par correspondance ou sur site lors des visites.
ou auprès de l'éditeur : Séminaires
|
| Haut de page | © IMCCE Tous droits réservés | http://www.imcce.fr |







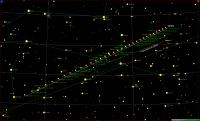


-small.png)

